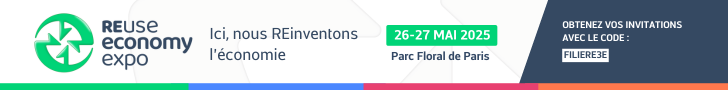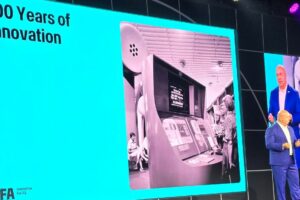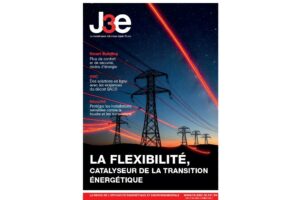Alors que la France est engagée depuis une décennie dans une transformation profonde de son mix énergétique et que l’électrification des usages s’accélère, le réseau électrique fait face à des défis inédits. Yannick Jacquemart, directeur Transformation de l’Exploitation du Système électrique et Intégration des Flexibilités chez RTE, revient sur les mutations historiques que connaît le système électrique français. Il y détaille les grands enjeux liés à l’adaptation du réseau, de la montée en puissance des énergies renouvelables aux évolutions géographiques et temporelles des flux, en passant par l’électrification massive de nouveaux usages, avec, en toile de fond, un impératif de flexibilité. Car si la production devient de plus en plus intermittente, il devient crucial de pouvoir ajuster la consommation. RTE accompagne cette transition à la fois en développant et en adaptant le réseau physique, en sensibilisant les parties prenantes au développement de flexibilités et en revoyant les processus de coordination avec les différents acteurs du système électrique.
Quels sont les principaux enjeux actuels sur le réseau électrique français ?
Yannick Jacquemart – Les enjeux sont multiples. Il faut d’abord adapter le réseau – au sens physique, qui comprend les lignes, les câbles – aux nouveaux composants qui s’y raccordent, qu’il s’agisse de la production, de la consommation ou du stockage. Cet enjeu est adressé par le Schéma décennal du développement du réseau (SDDR), publié récemment. Le SDDR reprend des éléments importants : lorsque de nouveaux équipements de production demandent à se raccorder dans des zones où il n’y a pas beaucoup de réseau, ce qui est le cas de l’éolien offshore ou des EnR terrestres, le réseau doit se développer. C’est vrai aussi pour le stockage ou pour les grandes zones de consommation, notamment les zones industrielles, où l’électrification amène à des puissances de demande de raccordement inédites. Nous vivons une période historique d’évolution du système électrique dans son ensemble et du réseau physique en particulier. La question de la taille du dimensionnement du réseau se pose pour répondre à ces évolutions. Au niveau géographique, beaucoup de nouveaux acteurs se raccordent sur la façade ouest de la France pour produire de l’électricité. Les consommations vont s’intensifier dans les grandes zones industrielles, en quelques points du territoire. Les échanges européens continuent de s’accroître vers l’est. Nous avons donc une problématique de sens des flux, à la fois de l’ouest vers l’est et du sud vers le nord, ce qui nécessite un renforcement du réseau de grand transport.
Le deuxième élément nouveau concerne le système électrique dans son ensemble – autrement dit l’équilibre de la production et de la consommation qui passe par le réseau. Les enjeux du système électrique sont doubles, avec des considérations sur le volume et le rythme.
En volume, l’histoire qui doit s’écrire est celle de la décarbonation, qui implique une augmentation à terme des consommations d’électricité. Pour le moment, l’augmentation n’est pas significative, mais elle a repris légèrement en 2024, et devrait s’accentuer dans les années qui viennent, l’électricité étant l’un des principaux vecteurs pour décarboner l’énergie. L’objectif d’ici 2050 est donc de tendre vers plus d’électricité pour moins de CO2.
Concernant les rythmes du système électrique, les moments où l’électricité décarbonée est très disponible sont en train de changer de façon structurelle. Historiquement, ces rythmes du système électrique étaient directement liés à la consommation. La production suivait cette consommation. Aujourd’hui, les rythmes sont créés par la consommation, qui n’a pas changé de tempo, avec des heures plus chargées en journée que la nuit, plus en semaine que le week-end, plus l’hiver que l’été. L’élément nouveau est le rythme de la production. Nous avons désormais une part significative de la production qui est non décalable : si elle n’est pas utilisée à l’instant T, elle est perdue pour la suite. C’était historiquement le cas de l’hydraulique au fil de l’eau, généré par les fleuves, et c’est aujourd’hui le cas pour l’éolien et le photovoltaïque dans des volumes importants. Cela crée naturellement deux nouveaux rythmes dans le système électrique. L’un lié au rythme du soleil, avec une production le jour, plus l’été que l’hiver. C’est ce rythme qui est le plus structurant dans la décennie actuelle. À la maille mondiale et européenne, le photovoltaïque se développe extrêmement rapidement. En 2024, il s’est installé en Europe 60 GW de photovoltaïque, soit l’équivalent de la consommation de pointe de la France l’essentiel de l’année. Entre 200 et 300 GW de solaire seront donc raccordés en Europe d’ici 2030, ce qui va peser très fortement sur la nature des flux et sur les prix.
Le deuxième rythme est lié à l’éolien, moins régulier et moins prévisible par nature, avec des périodes de quelques jours avec beaucoup de vent, suivies de périodes sans vent. À l’échelle française, et surtout européenne, la présence de vent en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne conditionne les équilibres, les opportunités d’importer ou d’exporter, les niveaux de prix… Le soleil et le vent créent donc un nouveau rythme du système électrique.
Nous avons désormais deux périodes où l’électricité décarbonée est très disponible et assez peu chère : la nuit, ce qui était déjà le cas historiquement, et la journée pendant les heures ensoleillées. Et donc deux périodes de pointes de prix, courtes : le matin entre 7 h et 9 h et le soir entre 18 h et 20 h. Il s’agit d’une donnée très nouvelle, qui ouvre un nouvel horizon à des flexibilités courtes. Cette nouvelle réalité est structurante, notamment pour le bâtiment. Auparavant, les incitations à l’effacement concernaient des journées très chargées l’hiver, et demandaient des réductions des consommations sur des journées entières. Ce besoin n’est plus aussi important. Il existe en revanche un intérêt plus fréquent dans l’année à éviter de consommer le matin et le soir sur les périodes de pointe de prix. Cette nouvelle réalité crée un besoin de flexibilité, qui est définie par la capacité de la production, de la consommation et du stockage à décaler des appels de puissance ou des injections de puissance sur le réseau, avec des préavis plus ou moins longs. Il y a aussi de la flexibilité programmée des années à l’avance, notamment la tarification des heures pleines et des heures creuses. Ces mécanismes de flexibilité visent à aider la consommation décalable, sans impact sur le confort, à se positionner au bon moment.
Comment le gestionnaire de réseau fait-il évoluer l’infrastructure pour répondre à l’électrification des usages ?
Y. J. – RTE développe et adapte le réseau physique aux nouveaux sites de consommation, de stockage et de production. Le SDDR à horizon 2040, qui prévoit un investissement de 100 milliards d’euros environ, sera soumis à débat public dans l’année qui vient. Dans le dimensionnement du réseau, RTE veille à permettre le raccordement de toutes les industries qui souhaitent venir en France, ou celles qui souhaitent se décarboner, mais aussi des producteurs d’électricité, des stockeurs, tout en veillant à un optimum technico-économique. Le réseau de grand transport européen va être dimensionné afin de faciliter les flux. Depuis 2019 et la précédente version du SDDR, RTE applique le « dimensionnement optimal », qui équilibre le développement du réseau et la diminution ponctuelle de la production. Cela signifie que le réseau n’est pas toujours dimensionné pour accueillir la production maximale lorsqu’elle est peu fréquente. C’est en particulier le cas sur les réseaux régionaux, et cela représente une économie pour la collectivité.
Par ailleurs, RTE dispose d’un programme de transformation du réseau pour intégrer les flux européens et renforcer les interconnexions. Cela permet à tous de bénéficier d’une électricité décarbonée, la moins chère possible, partout en Europe.
« RTE, en partenariat avec Enedis, lance la saison 3 de Cube Flex, qui démarre en mai, et se déroulera sur une année complète. »
Le sujet de la flexibilité est l’une des conditions pour adapter le réseau à la fois à l’augmentation de la demande et à l’intégration des énergies renouvelables. Pouvez-vous nous expliquer au travers de quelques exemples concrets les leviers pour apporter de la flexibilité sur le réseau ?
Y. J. – RTE a une action plus minime sur l’équilibre offre-demande. RTE agit sur la production et la consommation, exclusivement pour l’équilibrage du système dans la dernière heure. Tout ce qui se passe avant la dernière heure, c’est au marché de le faire. Les producteurs, les fournisseurs et les responsables d’équilibre effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité, sans aucune intervention de RTE. Concernant le développement de flexibilités, RTE a plutôt un rôle de conseil, au travers de sa fonction d’éclaireur, pour inciter au développement des flexibilités en amont, sur des régimes d’heures creuses ou des flexibilités dynamiques. Il s’agit d’une action de service public et non opérationnelle.

Dans le cadre de ce rôle d’éclaireur, RTE anime tout un écosystème, composé du Gimelec, de l’Ignes, de la SBA, de l’AICN, de l’Ademe, de la CRE, d’Enedis et de Think Smartgrids. Nous avons publié le Baromètre des Flexibilités, qui revient notamment sur la gestion énergétique des bâtiments tertiaires, le déploiement des BACS (ou gestionnaires techniques de bâtiment en français) et le projet 100 000 BACS à horizon 2030 du Gimelec. Nous poussons au développement des flexibilités régulières, qui englobent les heures pleines-heures creuses, et des flexibilités dynamiques. RTE a également contribué à la marque « Flex Ready », portée par l’association professionnelle des smartgrids, Think Smartgrids. Les BACS permettent d’optimiser le fonctionnement des différents usages électriques au sein du bâtiment. Flex Ready est une réponse pour coordonner l’optimisation générée par les BACS à l’optimisation du système électrique. Les BACS pourront donc adapter leur programmation aux signaux envoyés par des acteurs du système électrique, qu’il s’agisse de fournisseurs, d’agrégateurs ou du gestionnaire de réseau le cas échéant, pour des problèmes locaux ou des signaux EcoWatt. Les prix sont du simple au double entre le cœur de journée et les périodes de pointe du matin et du soir, il y a donc un intérêt à optimiser les usages décalables, notamment la recharge des véhicules électriques, la production de chaleur, la production de froid ou de glace, sans réduire le confort des occupants.
La troisième initiative est le concours Cube Flex, intégré aux Championnats de France des économies d’énergie. RTE est à l’initiative de ce concours, qui vise à l’apprentissage concret de la flexibilité. Nous avons organisé deux saisons durant les hivers 2022-2023 et 2023-2024. Ces deux éditions étaient centrées sur la flexibilité d’urgence, en cas d’alerte EcoWatt. RTE, en partenariat avec Enedis, lance la saison 3 de Cube Flex, qui démarre en mai prochain, et se déroulera sur une année complète. Cette édition vise les nouvelles flexibilités du quotidien, en mesurant la capacité des bâtiments à décaler leurs consommations de 2 heures le matin et le soir, tous les jours de l’année. Nous invitons tous les bâtiments tertiaires, qu’ils soient privés, publics, bureaux, commerces, sportifs, culturels, ou d’enseignement, à participer au concours. Cela leur permettra d’apprendre et de comprendre les ressources à mettre en œuvre au sein d’un bâtiment pour décaler ses consommations. Pour les participants, ces actions peuvent être valorisées par la suite, par exemple en leur donnant du poids pour négocier un nouveau contrat avec leur fournisseur.
« Les véhicules électriques représentent un potentiel, selon nos études, de 5 à 6 GW de consommation décalable. »
Selon vos prévisions, quel est l’impact de l’électrification des usages (véhicules électriques, pompes à chaleur, etc.) sur la pointe de consommation hivernale d’ici 2035 ?
Y. J. – C’est là que la flexibilité joue un rôle important. Il existe trois grands secteurs de l’électrification : l’industrie et le datacenter, la mobilité électrique et le chauffage électrique. L’industrie et le datacenter fonctionnent selon des usages dits « en ruban », c’est-à-dire qu’ils fonctionnent autant le jour que la nuit et autant la semaine que le week-end. Leur potentiel de flexibilité est donc assez faible et ces usages ne joueront pas, ou très peu, sur la pointe hivernale. Il existe éventuellement un potentiel de flexibilité d’urgence sur les datacenters, nous en discutons avec les acteurs.
Concernant la mobilité électrique, tout dépend de la façon dont les véhicules sont rechargés et du pilotage de la recharge. Il s’agit d’un enjeu de premier ordre. Si la recharge se fait au moment du branchement du véhicule sur une prise ou une borne, il n’y a pas de flexibilité possible. Les véhicules particuliers sont souvent branchés le soir en rentrant chez soi ou le matin en arrivant sur le lieu de travail, dans les deux cas en plein dans les périodes de pointe. Idem pour les flottes professionnelles, les véhicules se rechargent souvent en fin de journée. Les véhicules électriques représentent un potentiel, selon nos études, de 5 à 6 GW de consommation décalable. RTE a publié dans son bilan prévisionnel 2023 un chapitre sur la flexibilité qui souligne ces dynamiques. Le premier enjeu est donc de programmer la recharge, pas forcément de manière complexe, mais déjà hors des heures pleines, soit la nuit, soit au milieu de la journée, ou le week-end pour la recharge hebdomadaire. Côté réseau, cela permet d’agir considérablement sur la puissance de pointe, et côté client, cela a un réel impact sur la facture, avec les disparités de prix que nous avons évoquées.
Enfin, concernant le chauffage et notamment le passage à la pompe à chaleur, RTE a publié une étude en décembre dernier. Le chapitre 13 du bilan électrique sur le bâtiment montre que depuis 15 ans le volume d’électricité dédié au chauffage électrique n’augmente pas et reste aux alentours de 65 TWh, bien qu’il y ait de plus en plus de surfaces chauffées à l’électricité. Cette même tendance ressort dans nos prévisions pour 2035. En revanche, s’il y a davantage de chauffage électrique, cela va mécaniquement augmenter l’impact du chauffage en période de pointe. RTE, dans sa dernière étude, souligne que l’augmentation pourrait être de 6 GW à horizon 2030 et 4 GW à horizon 2035, par rapport à l’année de référence 2019. Cela ne pose aucun problème d’approvisionnement et l’enjeu CO2 est très important, car l’objectif est de remplacer les chaudières au fuel et au gaz. Sur les PAC, nous commençons à étudier des leviers de flexibilité. Nous serons très attentifs aux conclusions de Cube Flex. Nous ne sommes plus dans la situation où toutes les heures se valent et où le chauffage doit être baissé toute la journée. Si le bâtiment est préchauffé entre 6 et 7 h, qu’il est en maintien de température entre 8 et 10 h et que le chauffage est relancé à 10 h, l’impact sur le réseau est bien meilleur. Tout dépend de comment les 6 GW mis en évidence par notre étude sont modulés au cours de la journée. Pour un bâtiment tertiaire, s’il est chauffé jusqu’à 18 h, il n’est peut-être pas nécessaire de poursuivre la chauffe si le dernier occupant quitte les lieux vers 19 h 30. L’étude ne prend pas en compte ces rythmes de chauffage, il s’agit donc de leviers d’action supplémentaires. Les PAC air-eau présentent des caractéristiques d’inertie intéressantes, en raison du circuit d’eau chaude qui alimente les radiateurs, et c’est encore plus vrai en présence de planchers chauffants. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des PAC air-air, qui ont un effet plus immédiat sur les occupants en cas d’arrêt de chauffe. Nous devons donc apprendre ces éléments. Cube Flex est un beau terrain d’expérimentation et d’apprentissage.
Mais il ne faut surtout pas oublier que nous avons aujourd’hui un système électrique avec des records d’export, une très grande disponibilité de l’électricité décarbonée et prêt à accueillir la décarbonation dès maintenant. Ce sujet sur les pointes ne doit donc pas focaliser l’attention à très court terme.
« En 2024, l’électricité française était décarbonée à 95 %, ce qui en fait un formidable levier de décarbonation de l’économie. »
Avec la montée en puissance des EnR, quels défis pose l’intermittence et quelles solutions privilégiez-vous ?
Y. J. – Tous les sujets abordés précédemment sur les rythmes du système électrique concernent la prise en compte des énergies renouvelables. Le réseau s’est toujours adapté aux rythmes de la consommation. Il nous semble plus simple de s’adapter à des pointes très courtes et largement prévisibles. La priorité est de décaler la consommation qui peut l’être, car cette mesure peut être rapide et n’entraîne pas de question de matières rares à utiliser.
Il y a deux conditions indispensables dans la mise en œuvre.
La première est d’ordre technique et nécessite la bonne programmation des appareils. À travers les BACS, Flex Ready ou des programmateurs dans le domaine du résidentiel, il existe aujourd’hui des solutions.
La deuxième condition est d’avoir des offres de fourniture qui reflètent bien ces nouveaux rythmes. En 2024, sur l’ensemble de l’année, les prix moyens entre 10 h et 18 h étaient 65 % plus bas qu’entre 18 h et 20 h, et 144 % plus bas le week-end. La CRE fait évoluer le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) dans ce sens. Il faut que les fournisseurs ajoutent la part énergie pour suivre ces rythmes, qui doivent se retrouver sur les factures des clients. Cela encouragera les consommateurs à décaler leurs consommations.

Les batteries sont une autre réponse à ces enjeux. Elles rendent le même service que le décalage des consommations. Il faut cependant les acheter, les raccorder, les entretenir et il y a un enjeu de matières premières. Les batteries représentent un surcoût, car on ajoute un composant au système électrique, à l’inverse de la flexibilité de consommation qui est gratuite.
La plupart des pays du monde vivent ces mêmes enjeux liés aux énergies renouvelables, avec une production en journée assurée par le solaire, moins de consommations la nuit et la même pointe du soir et du matin. La Californie, par exemple, a remplacé le gaz par les batteries pour passer ces pointes du soir. Les batteries sont donc un levier complémentaire pour les flexibilités courtes.
La problématique se situe sur les périodes de plusieurs jours sans vent. Cela nécessite un mélange de flexibilités courtes et de flexibilités plus longues. Dans les autres pays, cette problématique ne peut être résolue que par les centrales à gaz. À horizon 2040 ou 2050 dans le monde, nous espérons avoir des centrales thermiques qui utilisent du gaz décarboné, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En France, nous avons une base nucléaire, hydraulique, solaire et éolienne qui nous aide à faire très peu appel au gaz. En 2024, l’électricité française était décarbonée à 95 %, ce qui en fait un formidable levier de décarbonation de l’économie.
Quelles sont les opportunités offertes par l’électrification de certains usages, à l’image de la mobilité ?
Y. J. – Il y a plusieurs usages possibles des batteries. Pour nous, le sujet premier reste le décalage de la recharge, au travers de la programmation, qui est neutre d’usage pour l’utilisateur.
Le deuxième usage est le Vehicle to Grid (V2G) ou Vehicle to Home (V2H), qui nécessite des batteries bidirectionnelles. Le marché tend vers ces solutions, techniquement saines à nos yeux, dans la mesure où les batteries servent en premier lieu à la mobilité et proposent une fonctionnalité complémentaire. Ces batteries sont très largement dimensionnées, car elles ont été conçues pour une grande autonomie de mobilité. Elles ont plus d’énergie que les batteries installées sur le réseau électrique, qui ne stockent que 1 à 2 heures de leur puissance maximale. Décharger une batterie de véhicule pour la consommation électrique de la maison, de l’ordre de 3 à 6 kW, permet de tenir 10 à 20 heures, alors qu’il suffit de 2 heures de décalage au maximum. Techniquement, c’est intéressant ; sur le plan environnemental, c’est intéressant, car cela évite de mettre une nouvelle batterie sur le marché. La question récurrente est celle de l’usure des batteries générée par la multiplication des cycles de charge/décharge. Dans la mesure où il ne s’agit pas de décharges extrêmes, l’impact est minime. La question de la rentabilité se pose, notamment en raison de la bidirectionnalité de la batterie et des convertisseurs. Il s’agit d’une voie d’avenir très intéressante. Vu du réseau, cela reviendrait à changer le rythme de la consommation, en rendant la courbe plus plate et en réduisant considérablement le besoin de flexibilité.
Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour inciter les gestionnaires de bâtiments tertiaires et industriels à contribuer à la flexibilité du réseau ?
Y. J. – Pour les flexibilités du quotidien, celles qui se programment soit longtemps à l’avance, soit la veille, le principal levier est la tarification des fournisseurs et le prix qui se reflétera sur la facture du consommateur. Nous regardons de près les nouvelles offres des fournisseurs, qui vont inciter les gestionnaires de bâtiments, tertiaires comme résidentiels, à s’adapter à ces nouveaux rythmes du système électrique.
Le dispositif EcoWatt est un deuxième levier, cette fois entre les mains du gestionnaire de réseau. Mais il s’agit d’un dispositif d’urgence, utile en cas de crise. C’est l’« airbag du système électrique » : l’objectif est de l’utiliser le moins possible.
« Le dispositif prévoit de saisonnaliser les heures pleines/heures creuses, ce qui est un élément nouveau : cela signifie que les heures pleines/heures creuses ne seront pas les mêmes en hiver et en été. »
Pouvez-vous nous expliquer dans les grandes lignes les raisons de la réforme du dispositif heures pleines/heures creuses ?
Y. J. – Le dispositif heures pleines/heures creuses est évidemment un levier de flexibilité. Il vaut pour le résidentiel, mais aussi pour le tertiaire, en moyenne tension et pour les consommateurs basse tension supérieurs à 36 kVA. Ce dispositif est régulé, via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. L’objectif est de décaler une partie des consommations vers les après-midi, au moins pour les mois les plus ensoleillés. Le dispositif prévoit de saisonnaliser les heures pleines/heures creuses, ce qui est un élément nouveau : cela qui signifie que les heures pleines/heures creuses ne seront pas les mêmes en hiver et en été. Pendant la période d’été, qui s’étale du 1er avril au 31 octobre, le gestionnaire du réseau de distribution devra positionner davantage d’heures creuses en après-midi plutôt que la nuit. Cette modification du dispositif interviendra en 2026. La CRE a annoncé préparer un deuxième temps, qui conduira à une augmentation du nombre d’heures creuses. Les heures de la nuit restent creuses et de nouvelles heures en journée vont devenir creuses. L’évolution à moyen terme, d’ici 2 à 5 ans, sera donc de passer à davantage d’heures creuses, au moins pendant les mois d’été.
Ce sont les 60 GW de solaire raccordés par an qui créent le mouvement. Tant que l’Europe développe du solaire à ce rythme, la part de la production non décalable, donc perdue si elle n’est pas utilisée, va aller en augmentant, et renforcera ces nouveaux rythmes. En 2024, pendant les épisodes de prix négatifs, c’est-à-dire lors des périodes de trop forte production renouvelable, il y a eu en moyenne 5 GW de production renouvelable perdue pendant ces heures. La réforme du dispositif va permettre de déplacer entre 7 et 8 GW vers les nouvelles heures creuses de l’après-midi. Les heures creuses sont vraiment de nature à éviter de perdre de la production d’énergies renouvelables décarbonées.
Propos recueillis par Alexandre Arène